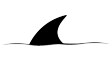Les requins-baleines de Madagascar : un nouvel espoir pour l'espèce ?
Le requin-baleine, le plus grand poisson au monde, est aujourd'hui en voie d'extinction, directement exposé à de nombreux risques dans nos océans, compromettant directement sa survie. À Madagascar, une importante population de requins-baleines a été identifiée par le « Madagascar Whale Shark Project ». En combinant la recherche au tourisme responsable, le projet propose une manière durable de protéger cet animal et son habitat. Le requin-baleine est un requin totalement inoffensif. Il a hérité de son nom du fait de sa grande taille, pouvant atteindre plus de 18 mètres, et de sa manière de s'alimenter. Le requin-baleine est inoffensif pour l'Homme. En effet, étant l'une des trois espèces de requin filtreur, il se nourrit exclusivement de zooplancton et des petits poissons en filtrant plus de 600.000 litres d'eau par heure par sa bouche et ses branchies. Malgré la présence de petites dents microscopiques, le requin-baleine est un requin gentil, curieux et surtout impressionnant par sa taille et sa robe aux mille points blancs. En malgache, le requin-baleine est connu sous le nom du « marokintana », le requin aux mille étoiles. Chaque année, les requins-baleines reviennent s'alimenter au même endroit et au même moment, le temps de quelques mois, afin de profiter de la présence de nourriture énergétique, qui leur permet de continuer leur croissance, comme les œufs de thons, le zooplancton ou les maquereaux juvéniles. Étonnamment, seuls les requins juvéniles, mâles, en majorité, reviennent se nourrir de manière saisonnière, comme aux Philippines, au Mexique, en Australie, au Mozambique, en Tanzanie et à Madagascar. Leur présence prévisible a donné naissance à un tourisme particulier, permettant aux touristes de nager avec les requins-baleines dans leur milieu naturel. Ce tourisme de plus en plus populaire peut bénéficier à la population locale et être un argument de taille pour protéger l'espèce et leurs habitats, s'il est géré intelligemment... En effet, malgré leur distribution dans plus de 19 pays, les requins-baleines sont, depuis 2016, une espèce en voie d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Depuis 2005, plus de 76 % de la population répertoriée au Mozambique a disparu, le canal du Mozambique étant pourtant l'une des zones les plus riches au monde en biodiversité marine.
Quelles sont les causes de sa disparition ? La cause exacte de leur disparition reste inconnue, mais entre la pollution plastique, la surpêche, la pêche accidentelle par les thoniers, les collisions avec les bateaux, et le réchauffement des océans, les risques sont largement répandus pour l'espèce qui atteint l'âge adulte vers les 30 ans seulement. Les observations de requins-baleines une fois adultes se font rares, l'espèce paraissant changer d'habitat et utiliser les profondeurs et les hautes mers, à la recherche d'un partenaire. Pouvant plonger à plus de 2.000 mètres et vivre plus de 130 ans, selon des études récentes, les requins-baleines peuvent rester sous l'eau pendant des mois entiers, ne revenant à la surface que pour se nourrir. On sait, suite à la capture d'une femelle enceinte en 1995 à Taiwan, que les requins-baleines sont ovovivipares, et peuvent donner naissance à, au moins, 304 petits. À ce jour, aucune autre information concernant la reproduction des requins-baleines n'est connue.
Lire l'article